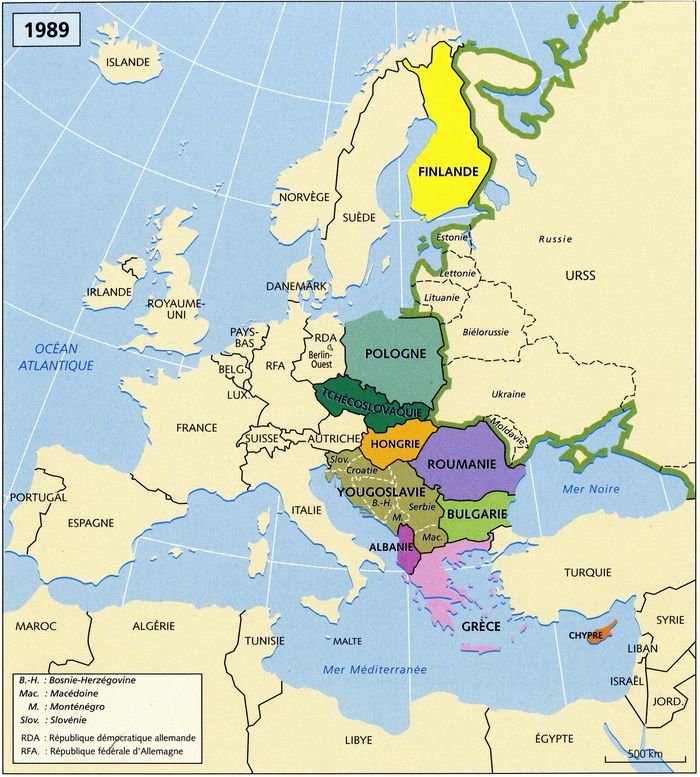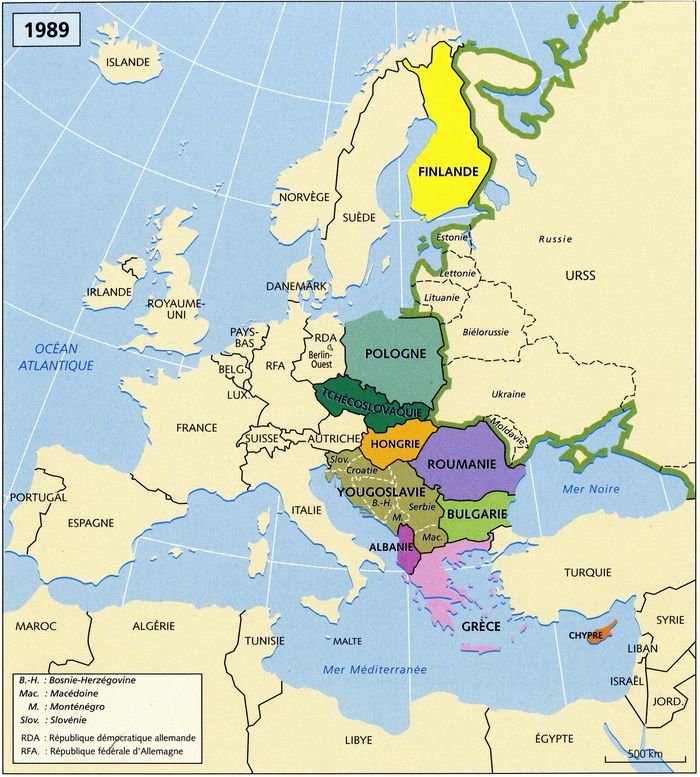
Effondrement de
l'URSS
Staline meurt en 1953 et une détente semble
s'installer avec l'arrivée de Krouchtev.
Pourtant,
en novembre 1956, une répression brutale
écrase une révolution en Hongrie.
En 1958, la Roumanie
obtient l'évacuation des troupes soviétiques ainsi que la
possibilité d'investir dans l'industrie, à l'aide de
capitaux occidentaux. En 1965, Ceaucescu arrive au pouvoir et accentue
la politique de son prédécesseur. Face à la crise
des années 70, il réalise une fuite en avant dans la
systémisation : destruction des villages remplacés par
des habitations collectives.
En
1961, Kroutchev fait édifier le mur de Berlin.
En
1964, Brejnev poursuit la même politique et intervient
militairement en Tchécoslovaquie pour empêcher
d'engager
des réformes (1968, "printemps de Prague").
En
Pologne, des révoltes ouvrières sont
écrasés : Poznan en 1956, Gdansk en 1970, Radom
en 1976.
En 1953, le cardinal Wyszynski, primat
de Pologne, est assigné à
résidence. Les manifestations de 68 sont
dénoncées comme des actions
sionistes qui donnent lieu à des actes
anti-sémites.
L'élection
du pape Polonais Jean-Paul II apporte un
réconfort
à l'opposition. Un confédération
syndicale
ouvrière "Solidarnosc" voit le jour en 1980, avant
d'être interdite par
le général Jaruzelski en 1981.
L'année
1983 est marquée par deux évènements
marquants :
la visite du pape qui demande l'application des accords de Gdansk
et l'attribution du prix nobel de la paix
à Lech
Walesa.
A Prague, en 68, Dubcek fait adopter des programmes trés réformateurs : c'est le "Printemps de Prague".
Les troupes russes occupent la tchécoslovaquie et imposent une
normalisation. En 69, deux républiques sont constituées :
tchèques et slovaques.
En 1977, Vaclav Havel lance la "charte 77" (liberté religieuse, de conscience...) et finit emprisonné.
En 1985,
l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev marque un tournant
avec la
mise en place de la perestroïka (restructuration). La
catastrophe
de Tchernobyl, en 1986, confirme les dysfonctionnements du
système soviétique.
L'année
1989 est marquée par la fin des démocraties
populaires.
En Pologne, une table ronde conduit à
des élections et au triomphe de Solidarnorsk.
Les Hongrois mettent fin à la république populaire et ouvrent les frontières avec l'Autriche.
A
Berlin, les manifestations conduisent à la chute du
mur.
En
Roumanie, le couple Ceausescu est
capturé et fusillé. Illescu prend la présidence en
s'appuyant sur les forces héritées du communisme. Les
privatisations sont limitées
et la corruption grandit.
En Moldavie, les minorités russes obtiennent un statut particulier dans la moldavie indépendante.
En Tchécoslovaquie, la révolution
de velours de Novembre conduit Vackav Havel à la
présidence.
La transition est
moins rapide en Bulgarie (1990) et en Albanie (1991-1992).
En 1992, la Slovaquie proclame sa souveraineté.
En
Aout 1991, Gorbatchev doit faire face à un putsch qui tente
de
restaurer le régime d'avant la perestroika. Les présidents russes, ukrainien et biélorusses
déclarent que l'URSS a cessé d'exister et fondent
la CEI.
En Yougoslavie, suite à la situation économique catastrophique et à la
mort de Tito (80), des tensions sont apparues entre Slovénie, Croatie
(riches) et Bosnie, Monténégro, Macédoine.
En 1990, des élections ont
lieu dans chacune des républiques :
- La
Slovénie et la Croatie proclament leur
indépendance en
juin 1991. Mulan Kucan est élu président de Slovénie et mets en place un régime stable.
- Une guerre entre serbe
et
croate éclate en Croatie.
-
La Macedoine accède à
l'indépendance en 1991. Un musulman est élu
président de la république. Le 1/4 de la population est
Albanaise ce qui génère des tensions (94 à 97),
- La
Bosnie-Herzégovine accède à
l'indépendance
en 1992, ce qui provoque une guerre complexe entre les
différentes communautés. Elle ne prendra
fin qu'en 1995.
Les
serbes, autour de Slobodan Milosevic, ont un projet de "Grande Serbie".
Serbes et Croates s'affrontent en Croatie (Split, Zagreb, Dubrovnic).
L'indépendance de la Slovénie et de la Croatie est
reconnue en 1992 avec un bilan de 10 000 morts. La guerre se prolonge
en Bosnie où a lieu un épurage ethnique : l'objectif des
Serbes est d'éliminer la population musulmane. Les croates
essaient, de leur coté, de constituer un territoire purement
croate à intégrer à la Croatie. En 1994, la paix
est signée avec les Croates. Les serbes essaient de s'emparer
des enclaves musulmanes : en 1995 ils s'emparent de Srebrenica (7
à 10 000 morts) et Zepa. En nov. 1995, un cessez le feu est
enfin signé : la guerre aura fait 200 000 morts.
En 1991, les
Albanais du Kosovo proclament leur indépendance. En 1996,
Milosevic ordonne le nettoyage ethnique de Kosovo, qui entraine un
afflux de 700 000 personnes dans les pays voisins. En 1999, les forces
de l'ONU se déploient au Kosovo.
En
1990, l'Ukraine proclame sa souveraineté et accepte le
projet
d'union rénové proposé par l'URSS. En
décembre 1991, l'indépendance est
proclamée et il
est mis fin à l'URSS. L'Ukraine doit restituer
l'arsenal
nucléaire russe mais bénéficie d'une
importante
aide américaine en compensation. Elle hésite
à
privatiser, de peur de provoquer des mécontentements
sociaux, et
cela malgré la dégradation des
équipements.
Une
partie de la population, à l'ouest, aimerait se tourner vers
l'Europe tandis qu'à l'est, elle est attachée
à la
Russie. Les dernières élections ont
été
remportées par des présidents "de l'Est".
En Bulgarie, suite aux protestations de la Turquie face à une politique
d'assimilation, ce sont de nouveau 300 000 turcs qui passent la
frontière en 1989. La moitié reviendra en 1990-1991. Le parti communiste se mue en parti socialiste.
En
Albanie, dés 1990, les frontières sont ouvertes mais les
difficultés économiques amènent la victoire du
parti démocrate en 1992. En 1999, elle a aceuillit plus de 400
000 réfugiés provisoires du fait de la guerre en Serbie.
Pays
du Nord
La pression soviétique se relache avec la
mort de Staline en 1956. La Finlande
entre
dans le Conseil Nordique en 56, à l'Association de Libre
Echange
(AELE) en 1962 et constitue un pont entre les deux blocs. En 1973, elle
acceuille la Conférence pour la
Sécurité et la
Coopération en Europe (CSCE).
Les relations avec la
russie
sont normalisées aprés 1991. En 1994, un
social-démocrate est élu président.
En
1995, la Finlande devient menbre de l'Union Européenne.
L'Estonie
est indépendante en 1991 et ne reconnait comme citoyen
estonien
que ceux de 1940 et leurs descendants : les russophones n'ont
pas
droit de vote. La maitrise de l'Estonien est imposée pour
obtenir la naturalisation et les tensions avec les russophones se
durcissent.
Comme l'Estonie, la Lettonie
est indépendante en 1991 et ne reconnait que les citoyens
d'avant 1940. Les dernières troupes russes quittent le pays
en
1994.
La Lituanie
se déclare indépendante en
1990, poussée par le mouvement lituanien de restructuration,
le Sajudis.
Elle est reconnue en 1991 par l'URSS.
La
citoyenneté par la langue indispose les russes (10%) mais
surtout la minorité de langue polonaise. La privatisation
des
terres provoque une désorganisation. Un accord de
coopération est signé avec la Pologne en 1994,
excluant
toute contestation territoriale.
En 1986, la Biélorussie
subit de plein fouet la catastrophe de Tchernobyl. En 1990, elle
réclame sa "souveraineté" mais est
partagée entre
rénovation et indépendance. Elle
réclame son
indépendance en 1991 et adopte le nom de
Biélorussie
(=russe blanc).
En 1995, un référendum
approuve les
relations économiques renforcées avec la russie,
le
rétablissement du russe comme langue officielle
(à
cotè du biélorusse).
Grece et Chypre
En
1967, le coup d'état militaire amène le "régime
des colonels" au pouvoir jusqu'en 1974. La Grèce intégre
la CEE en 1981.
En 1960, Chypre accède à
l'indépendance. En 1974, au refus du départ des
officiers grecs répond le débarquement de forces turques
dans l'île. Les forces turques prennent position : l'île
est séparée en deux avec une républqie du nord
reconnue uniquement par la Turquie.
 300 1250 1500 1648 1750 1812 1815 1885 1925 1942 1989 2007
300 1250 1500 1648 1750 1812 1815 1885 1925 1942 1989 2007