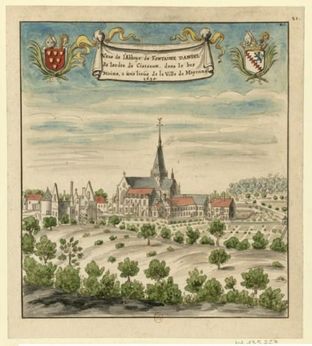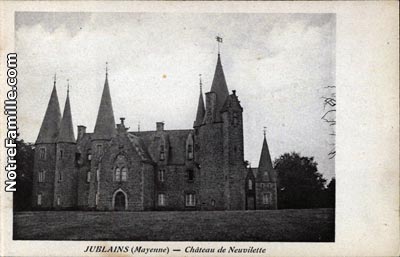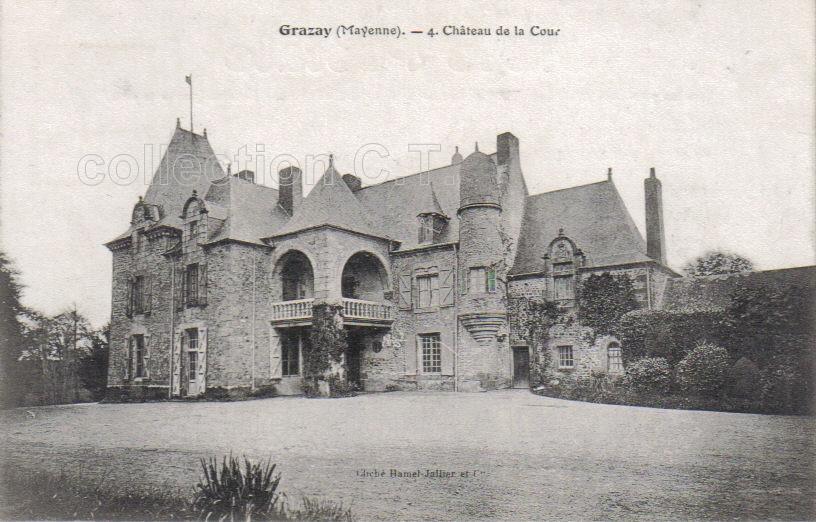Introduction
En constituant
l'arbre
généalogique de ma famille, je suis parti à la recherche des sources plus ou moins lointaines de
son identité, à la reconnaissance des ancêtres,
à travers les quelques documents qu'ils ont laissés
derrière
eux.
Les
documents sont souvent réduits
à quelques bribes d'informations sur une vie : un lieu de
naissance, un mariage, un métier... Il faut alors faire preuve
de persévérance et d'imagination pour comprendre le
passé : pourquoi a t'il
quitté son village de naissance ? Pourquoi
a t'il
abandonné le métier de maçon pour
celui de
cultivateur ?
Bientôt toutes ces
questions s'accumulent et augmentent avec le nombre des
ancêtres.
Plus on remonte dans le temps et plus le nombre d'ancêtres
augmente, en même temps que les documents se
raréfient.
Très vite,
l'identité de la famille se confond avec celle d'un groupe social,
d'une région, voire d'une religion... à laquelle elle
appartient. La recherche prend alors une toute autre nature et ne peut
avoir de sens que si elle s'élargit elle même pour
englober la population qu'elle représente.
Fils
d'agriculteur, je
suis d'un milieu de "paysans" établi sur le canton de BAIS,
au
Nord Mayenne. Les ramifications de la famille couvrent essentiellement
le Nord/Ouest de la Mayenne, mais aussi un peu la Sarthe, cette
région que l'on appelle le Bas Maine, en opposition au haut
Maine centré sur Le Mans.
La recherche de
l'identité de ma famille, après une description
généalogique qui remonte difficilement avant le
révolution française, se centre donc sur l'histoire
d'une famille de paysan du Bas Maine à travers les
âges, objet du présent document.
Bibliographie
De nombreux textes sont
"empruntés" à des
personnes plus
savantes que moi, que je remercie et sans qui ce document n'aurait
jamais pu voir le jour.
La
lointaine préhistoire (-400
000/-6 000)
Le premier peuplement
attesté dans la région a
été
révélé par la découverte de
plus 300 haches
prés du Montaigu, et dont la datation a
été
approximativement de -400 000 ans. Débité dans un
quartzite local, on a pu en retrouver dans les landes de
Chellé
(Hambers) et d'Eugéneville. On en a trouvé
également en
silex alors qu'on ne connaît pas de gisement de silex en
Mayenne.
Les premiers
hommes
étaient des chasseurs-prédateurs qui utilisaient
des
instruments en pierre non polie : bifaces, pointes, racloirs,
denticulés pour chasser.
Vers 50 000 av J.C, le
climat devient particulièrement rigoureux. L'auroch, le
renne, le grand cerf, l'hyène, l'ours
des
cavernes, le bison, le rhinocéros laineux et
l'impressionnant mammouth
vivent dans le Maine : des ossements de tous ces animaux
ont
été retrouvés dans la grotte de Rey
à
Saint-Georges-sur-Erve,
la grotte de Louverné ou celle de Voutré.
Ils ont également été
dessinés : on reconnaît ainsi un mammouth et un
bison dans
les grottes de Saulges
à Thorigné.
Les premiers
hommes
pratiquent également la cueillette (chataigne, gland...),
comme l'atteste des
scènes peintes et des bois de renne sculptés,
retrouvés dans le Creuse de Fontgombault (Creuse).

Peintures de la
grotte Mayenne-Science |
Pour s'abriter, les calcaires des grottes préhistoriques
offraient aux tribus paléolithiques un refuge sûr,
comme
à Saulges
où un ensemble de
grottes (cave à Margot, cave de Rochefort) ont
été retrouvées sur les
deux rives de l'Erve. |
Bergers
et
Laboureurs -8 000/-800A
partir de 6000 av
J.C., favorisé par l'adoucissement du climat et
poussé
par l'augmentation de la population, c'est la domestication des animaux
et la sédentarisation qui va permettre la conversion des
chasseurs en bergers. Utilisant le chien domestiqué comme
compagnons de chasse (-6000), les premiers hommes découvrent
ses
qualités de gardien de troupeau et pratiquent
bientôt l'élevage
de moutons (-6000) puis de bœufs, chèvres
et porcs (-5000).
Les premiers laboureurs
qui utilisent des bois de cerf durci au feu pour remuer la terre,
découvrent
la houe (-3000), renforcée d'un silex
et avec
laquelle le travail devient moins superficiel. Ces progrès
furent renforcés par l'arrivée de
l'araire
: importé de civilisation très en avance sur la
notre
(Egypte et Mésopotamie à l'origine de la roue et
du
blé), elle apporta beaucoup à l'agriculture en
permettant
de creuser la terre au lieu de la gratter seulement. Elle fut
complétée par la
domestication du cheval
(-1200),
fort
utile pour tracter et non seulement comme bête de viande.
Tous
les outils sont
d'abord en bois puis en pierre polie
et enfin en
bronze vers 1700 av JC. L'introduction du bronze a
laissé
très peu de trace : quelques haches à Hardanges,
Jublains. Les hommes quittent alors les cavernes pour
des huttes et des
cité lacustres.

Allée
couverte de Vautorte |
Entre
5 000 et 2 000 ans, des dolmens
et des menhirs
sont dressés à l'orée des bois,
dans un but religieux ou
funéraire, sous
les
directives des druides.
|
Dolmen
des Erves - Sainte Suzanne | Des
vestiges témoignent de cette
présence dans la vallée de la Vaudelle, un des
sites les
plus anciens des centres de peuplement du Bas Maine : les menhirs d'
lzé
(le Tellier et le Gué-Péan), le dolmen de la
thébauderie de Saint Thomas de Courceriers, les
sépultures de Sainte-Jemmes-le-robert,
Saint-thomas-de-courcerier
ou de Saint-pierre-sur-orthe.
Pour plus de
détail suivre
le lien |
De
nombreux objets en
céramiques ont
également été trouvés, en
particulier dans
les tombes : perles et pendeloques, tesson de poteries...
Les
celtes
à
l'origine de nos
provinces (-800/-50)
En
l'an 800 avant J.C., une population CELTE
basée en Europe
centrale à Hallstatt en Autriche avance par le Danube, le
Rhin,
la Moselle à travers une piste que l'on peut identifier par
ses
fosses circulaires. Ils arrivent en conquérant et sont
porteur
d'une nouvelle technologie
la métallurgie du fer
(inventée par les hittites en l'an -1500). La possession
d'armes
en fer constitua vraisemblablement un argument convaincant pour
favoriser leur installation dans le Bas Maine.
Une
deuxième
vague, en l'an -600 venant de La Tène (Suisse), les Galli,
marque l'installation définitive des celtes et a
laissé
de nombreux noms à nos forêts et nos cours d'eau.
Cette
appropriation du sol gaulois
par une
population CELTE de plus
en plus croissante fait dire à TITE-LIVE, dans son histoire
romaine que "la gaule fut si féconde en récolte
et en
hommes qu'il parut difficile de gouverner la foule
débordante de
ses habitants". Les romains affirment également la
ressemblance des celtes avec les germains qu'ils qualifient de
"véritables celtes" : germanus en latin !
Une colonie de CELTES, partit en
conquérant en
Italie où ils fondèrent Mantoue et Côme
(-600); puis ils
gagnèrent la Bohème, l'Illyrie, la
Macédoine et
enfin l'Asie mineure où ils établirent des
colonies. Ils ravagent Rome
(-390) avant de se rallier aux
romains, en 218, dans son combat contre Hannibal.
D'autres
déposent les
armes et
s'adonnent à
l'agriculture.
Dans le Maine, de grands chantiers
de
défrichement voient le
jour permettant l'accroissement des terres cultivables. L'agriculture
s'améliore avec l'usage de la faux, des amendements et
de la
moissonneuse (char
à deux roues qui porte sur son coté une lame
aiguisée),
ce qui ne laisse pas Rome indifférent qui
exploitera les qualités de cette région en
exigeant
toujours plus de rendements (il est vrai très faible 1 grain
1/2
récolté pour 1 grain semé).
César,
dans la guerre des gaules décrit le peuple AULERQUES comme
un
"peuple maritime qui habite les rivages de l'océan", ce qui
laisse supposer que le territoire s'étend jusqu'au Mont St
Michel. Les peuples d'Armorique partagent la même culture
comme
en témoignent le style des céramiques, le mode
d'aménagements du territoire, la monnaie d'or...
 | |  | | Les
colonies CELTES qui s'installent dans le Maine
sont des DIABLINTHES
du groupe des AULERQUES. Ils
rentrent dans un ensemble couvrant l'Armorique. |
La Paix
Gallo-Romaine (-50/250)
Lors
de la
conquête des Gaules par Jules César, les
Cénomans
envoyèrent des troupes à VERCINGÉTORIX
en 58/59.
Le guerrier Aulergue COMULOGENE lutta à ses
cotés,
à ALESIA, en 52, avant de se soumettre aux vainqueurs.
En 51,
César soumets les
derniers irréductibles et la paix
Gallo-Romaine s'installe pour plus de 200 ans.
Elle sera marquée par le développement de
l'urbanisation (fondation de Jublains),
des voix de communication et de l'artisanat. En
s'établissant
dans le Bas Maine, les romains introduisent dans le pays leurs
mœurs, leurs habitudes et jusqu'à leur langue.
Des éperons
fortifiés pour les agriculteurs et les artisans du
métal appelés
Oppidas sont
construits (à Moulay et Entrammes pour protéger
le gué sur la Mayenne...etc) et un premier réseau
de communication
: le chemin de bœuf (Chartres/Angers), le chemin gaulois
(Tours/Vieux en Normandie) et un chemin vers l'ouest avec une
bifurcation vers Rennes et une autre vers Jublains
(Noviodunum), capitale
du clan
des Aulergues Diablinthes.

Les
thermes |
Jublains et Le
Mans : les villes autour desquelles les Romains organisent la
vie de la cité. Autour
de ces villes, sont
créés les exploitations agricoles ou "villas".
| 
La
forteresse |
Les
romains transforment les tribus gauloises, très rurales, en
cité
organisée autour d'une ville
: Le Mans pour les Cénomans, Angers pour les
Andécaves et Jublains
pour les Diablinthes (recensée par
Ptolémée an II
ap JC). Devenue cité romaine, carrefour
stratégique
d'où rayonnent huit grandes voies, Jublains est alors une
ville
importante avec ses
thermes, son théâtre, son temple et son forum.
Jublains devient un lieu d'étape entre l'Armorique, la
Manche et le reste de l'empire.
De grandes
exploitations
agricoles, les Villas,
s'installent le long des axes de communication.
Un de ces domaines ruraux est donné en 642 à
l'abbaye
d'Évron la villa
Baidiscum (le domaine des gens de Bais),
qui donnera naissance à l'actuel chef-lieu de canton de Bais.
Les villas sont gérées par des "colons"
attachés
à la glèbe (la propriété
terrienne) et
produisent des
céréales, des troupeaux,
du vin et
des
fruits. Ils apportent
avec eux les cerises,
pêches, poires
mais
aussi les fèves et
les choux.
L'organisation
sociale
s'articule autour de riches propriétaires de villae -
romains ou
nobles gaulois-, de petits paysans
libres et propriétaire
et
d'une multitude d'esclaves ou
de demi-affranchis.
Organisation sociale
imposée par l'ordre romain qui volera en éclat
avec les
invasions barbares, l'émergence d'une nouvelle religion et
la
déliquescence de l'empire romain.
Soumis aux
taxes de
l'état romain, des propriétaires ou aux
armées en
vadrouille, le petit paysan doit sa survie à sa soumission
et
son travail.
Les
Invasions barbares
et l'arrivée des francs (250/300)
A
partir de
235,
l'Empire s'enfonce progressivement dans une crise militaire
(invasions), politique, économique, sociale et morale. Pour
assurer sa défense, la Gaule fait même
sécession de
260 à 274. Les "barbares", Vandales et Alains
essentiellement,
traversent le Maine en une effroyable tempête, ravageant sans
pitié toutes les cités.
Dés
le IVe, les
Francs,
à leur tour, envahissent le Maine puis y installent
une
aristocratie qui se substitue à l'aristocratie romaine. Le
roi
franc REGNOMER
prend le titre de roi des Manceaux et règne sur la Mayenne
et la Sarthe.
En
Mayenne
Partout
l'on enfouit des
trésors monétaires. A Jublains, celui de la
Cruchère
est enterré en 268, celui de la
Tonnelle vers 276, une
bourse de petites monnaies est glissée sous une pierre de la
forteresse.

Les
bains du Rubricaire | La forteresse
du rubricaire de St Gemme-le-Robert
témoigne de la résistance des romains
à la chute.
A 10 km de Jublains, la forteresse du Rubricaire
s'élève
sur le versant du mont Rochard et bénéficie d'un
large
panorama ouvert sur le bassin de Laval. Elle dessine un
quadrilatère d'une quarantaine de mètres de
côté, comportant sans doute une tour
carrée
à chaque angle.
A
l'intérieur, un second
quadrilatère délimite des casernements
appuyés
contre la muraille. Il s'agit vraisemblablement d'un ouvrage militaire
de la fin du IIIe ou du IVe siècle, du type que l'on appelle
quadriburgium. Deux côtés du rempart sont
recouverts par
un important talus, dans lequel on peut voir une remise en
état
de défense à l'époque
médiévale.
|
Le
relais
routier de Jublains, à l'écart des routes servant
à ravitailler les troupes massées aux
frontières
de la Germanie, perd son intérêt. A l'abandon de
la
forteresse, répond le déclin
durable dans lequel
s'enfonce la ville. Vers la fin du IVe ou au début du Ve
siècle, la cité
des Diablintes elle même disparaît,
fusionnée à celle des Cénomans de la
Sarthe.
Dans
les campagnes
Les paysans doivent à maintes reprises s'enfuir
dans les
bois, abandonnant leur terre et leur village. Les friches et les landes
gagnent sur les champs et les près. Des villas
disparaissent à tout jamais.
L'organisation
sociale
sophistiquées et les voix de communications
implantées
par le romains ne survivent pas à leur départ.
La
capitale "Jublains" disparaît également,
reportant
l'installation définitive d'une ville dans le Bas Maine
à
la fin du Millénaire.
L'avènement
du Christianisme (300/800)
Peu
après ces
ravages, le christianisme fait son apparition. En 312, l'empereur
CONSTANTIN proclame sa foi. En 392, l'empereur THEODORE
établit
le christianisme en religion d'état.
Les
temps mérovingiens et les comtés
En
481, les Francs
élisent un très jeune roi, CLOVIS qui va unifier
toute la
Gaule sauf l'Armorique et qui met fin à la
royauté du
Mans en faisant assassiner REGNOMER, dernier roi du Mans. Le Maine sera
désormais sous l'autorité des francs, et
placé entre les mains de comtes garantissant la paix de
façon à peu prés
indépendante.
La
conversion
de CLOVIS au christianisme conforte l'église dans son
rôle
d'évangélisation. La lutte contre le paganisme
est
accentuée dans ce monde éloigné des
grands centres
urbains où la christianisation progresse lentement.
Dans
les diocèses
s'installent, au cours du VIe et VIIe siècles, les
comtés
avec leurs administrations civils et leur chef militaire. Le
comté du Maine est ainsi créé. Comte
et évêque, représentants du pouvoir
impérial et du pouvoir ecclésiastique,
maintiennent pendant le moyen âge, dans le cadre de leur
province, l'autorité souvent défaillante du
gouvernement
central.
La
paix Carolingienne
Suite
à la
mythique bataille de Poitiers (732), Charles Martel et pépin
le
Bref se forgent une réputation de défenseur de la
chrétienté et installent les Carolingiens
à la
royauté.
En
768, CHARLEMAGNE
réorganise l'administration des provinces
en 191 comtés et fixe la répartition du pouvoir
entre le
comte et l'évêque : au comte la
défense, le
ravitaillement et l'ordre public, à
l'évêque la
justice, l'approvisionnement et les voiries.
La paix
ROI-EVEQUE
s'installe jusqu'au règne de CHILDERIC III et les invasions
des
normands. Les clercs dans les villes (Le Mans) commencent à
se
livrer à de savantes études.
Création
de la cathédrale du Mans par St
Julien
La
conversion du Maine est
l'œuvre de St
Julien,
1er évêque du Mans (301/348) qui
procéde
à des
miracles : il fiche son bâton pastoral en terre et en fait
jaillir de l'eau, il rend la vue à des aveugles et
répand
la bonne parole parmi la population urbaine...
Cette
conversion va
établir LE MANS comme nouveau centre politique,
économique et spirituel du Bas Maine, consacrant ainsi le
déclin de ce qui fut l'antique cité des
Diablinthe. Des
diocèses s'organisent dans les limites des cités
gallo-romaines, maintenu à peu prés dans leur
limite
jusqu'à l'époque actuelle. A travers elles, nous
retrouvons les divisions territoriales de la Gaule romaine, elle
même héritière de la gaule celte.
La
conversion
gagne plus tardivement les campagnes
où l'on continue néanmoins de
vénérer les
sources, les chênes et les mégalithes. Les
domaines des
villas servent maintes fois de cadre aux paroisses
créées
au cours du V et VI et qui se perpétuent dans nos communes
actuelles.
Création
de l'abbaye d'Evron
A
la fin de l'Antiquité, la
Mayenne apparaît comme une région peu
peuplée et isolée.
L'abbaye
d'Evron fût
construite au VIIe siècle par l'évêque
du Mans, Saint Hadouin, suite au miracle de la Sainte-Epine : la
légende dit qu'un pèlerin fatigué posa
sa besace près d'une source au pied d'un aubépin
qui grandit tellement dans la nuit qu'il ne pouvait plus l'atteindre,
les gens d'Aurion ne pouvaient l'abattre... Hadouin,
l'évêque du Mans, était en visite et se
mit à prier, la branche s'inclina et la besace vint se
placer dans ses mains. Hadouin fit bâtir en ce lieu une
abbaye et un sanctuaire dédié à Notre
Dame de l'Epine.
Les
reliques de
Marie
transportées par un pèlerin ont
été retenue
en ce lieu.
Il
reste
peu de trace archéologique du haut Moyen Age en dehors de
ces
sarcophages de pierre où était placés
les morts.
Les
cerceuils en calcaire coquillier renferment des bijoux, plaques de
ceinturons, agrafes. La riche tombe d'Argentré permet
d'entrevoir une
aristocratie
foncière à travers un mobilier
funéraire où
se mêlent traditions romaines et apports
germaniques. L'abbaye,
quand à elle, a
été entièrement détruite au
cours
d'invasion bretonnes et scandinaves, puis reconstruite à
partir
de 980. | 
Crypte
de l'abbaye d'Evron |
Dés
le VIIe, la vie s'organise autour de l'abbaye d' Evron
à partir de laquelle se développe la
christianisation.
Avec
la disparition
de Jublains, il ne
subsiste aucune ville mais la vie rurale connaît un nouvel
élan.
La paix est
favorable
aux fondations monastiques : de nombreuses églises ou
d'ermitages sont créés.
L'abbaye
d'Evron
prospère
et de nombreux ermites comme saint Céneré, saint
Fraimbault, saint Thuribe...etc s'installent dans la région.
Un
ermitage est fondé en 850 à Mayenne par
Saint-Aldric,
évêque du Mans. Les voies romaines ne sont plus
utilisées : elles ont été
remplacées par
des voies de communications centrées sur l'abbaye d'Evron.
A
Jublains comme
à
Entrammes, les thermes publics, à l'abandon, sont
transformés en églises.
ci-contre les thermes d'Entrammes. |
 |
Dans
les campagnes
L'abondance
des landes
favorise le développement des ermitages et l'installation de
nouveaux monastères contribuant à
l'évangélisation et la mise en valeur du
territoire.
Les
villas
deviennent
désormais propriétés de
l'église et les
monastères
prennent désormais une place importante dans leur
administration. Auprès de chaque fondation monastique se
groupe
une paysannerie en quête de terre
à cultiver. Sous
la direction des abbés, les serfs
(personne
attachée
à une terre, la glèbe, et
propriété du
seigneur au même titre que cette terre) et les vilains
(paysan
qui louent la terre) défrichèrent de nouvelles
paroisses
dans les forêts du Maine.
L'ordre
social
hérité des romains n'a pas subit de changement
fondamental. L'enrichissement des monastères est certain,
comme
en témoigne le testament
de Saint Hadouin qui
décrit les
richesses d'une des villas de son domaine : maisons,
édifices,
terres, forêts, esclaves (serfs) et pâturages au
détriment d'une paysannerie inféodée
au
monastère et pauvre.
Cependant
les villas
n'accaparent pas toute la vie rurale : un peu partout, il reste des
villages de paysans libres et propriétaires, qui restent
néanmoins tributaires des villas pour leur protection.
On
ne
note
pas
d'évolution significative dans la façon de
travailler la
terre et les rendements restent médiocres, atteignant
difficilement deux pour un. Cependant, encouragés par un
moine
Irlandais Colomban
(543-615),
les moines imposent un système d'agriculture
organisée :
défrichement des
landes, gestion du sol
(jachère),
relevé des rendements qui permet de faire reculer le spectre
de
la famine. Celle-ci est d'autant plus vive que la période
est
difficile : période de rigueur climatique (grands froids
jusqu'en XIIIe), épidémies de peste en 543 et de
lèpre qui sévissaient en permanence et
brigandage.
Pacification
des Bretons
Le
territoire à l'ouest de la
Mayenne, frontière avec la Bretagne,
est appelé "Marche de Bretagne".
Pour repousser les pillards bretons, des garnisons y sont
disposées. Une des permière fut,
parait-il, confiée à
Roland. Aprés
lui, Guy, premier comte de Laval, fut son successeur.
En
636, le
breton Judicaël, vainceur sur Dagobert, fera une incursion
jusqu'à Vaiges
et Saint-Pierre-sur-erves, faisant un grand carnage.
Louis
le débonnaire, puis
Charles le chauve allèrent chatier les bretons et obtinrent
l'abdiction de leur roi Salomon en 862, à Entrammes, en lui
concédant les "terres d'entre deux eaux", c'est à
dire une partie des marches de Bretagne (la Mayenne en fait partie). En
867, la Bretagne atteint son extension
géographique maximale.
Invasions
normandes et
naissance de la Noblesse (800/1000)
Les
invasions
Les
invasions
reprirent
du IXe au XIe siècle avec les normands (vikings) remontant
la Loire et
ses
affluents sur leurs barques légères. Les
villes et les
monastères sont détruits. Seul le
monastère
d'Evron, détruit en 853, se relèvera de
ses ruines.
Le chateau de Laval est pillé (834) puis
détruit
(865) de fond en comble. La nouvelle ville de Jublains est
définitivement détruite et ne se
relèvera jamais.
Les paysans
apeurés
abandonnent de nouveau leurs terres et leurs villages.
Les
populations se
réfugient derrière les étroits
remparts du IIIe
siècle. Associant talus, ouvrage de pierres et palissades,
les
premiers retranchements sont rudimentaires.
En
912, le roi de France abandonne la Normandie aux Normands mais ceux-ci
veulent également le Maine qu'ils vont s'efforcer de
conquérir pendant quarante ans. Ils s'emparent
d'Ambrière
où ils font construire un chateau en 1055, puis de
Mayenne
en 1064 et l'ensemble du département. A l'occasion de la
conquête de l'Angleterre par les normands, le duc de
Bretagne,
Conan II se révolte et s'empare de Chateau Gontier. Guillaume le fait empoisonner et
repart à la conquête de la Mayenne.
Le
château
fort de Sainte-Suzanne,
solidement assis sur un éperon rocheux, est le seul
bastion qui résiste
aux assauts de Guillaume le conquérant qui fit pourtant un
siège de trois ans de 1083 à 1087.
Les
châteaux forts
De
nouveaux
systèmes de défense deviennent
nécessaires : les
comtes et les évêques décident de la
construction des châteaux forts et des forteresses
destinées à défendre leurs artisans et
leurs
marchands. De guerre féodale en lutte pour le pouvoir,
naissent
ainsi des édifices plus ou moins puissants.
| Arcades
carolingiennes du
château de Mayenne | A
Mayenne,
le modeste châtelet de bois des origines fut
remplacé par
un fort carolingien qui
prit une grande valeur stratégique.
Au début du
XI ème siècle, Foulques Nerra,
compte d'Anjou et suzerain du lieu, inféodait la baronnie
déjà importante de Mayenne à Hamon
de Mayenne, tige de la famille des Juhel,
premiers seigneurs de Mayenne. C'était alors une place si
forte
que Guillaume le Conquérant, lui-même ne pu s'en
saisir en
1063 qu'à la faveur d'une ruse "de Normand".
Les
travaux
d'agrandissement de la forteresse furent poursuivis par les Juhels
jusqu'au début du XIII ème siècle, et
essentiellement par Juhel II, baron de 1124 à 1161,
père
de 6 fils, qui donna à la ville de Mayenne ses armes
figuratives : "six écus a, mais pas un sol".
|
Mayenne
 | Sainte
Suzanne
 |
Lassay
 |
A
Laval,
autour d’une motte, puis d’un grand donjon,
s’ordonne
un bourg prospère cerné de murailles qui, par son
nom
même, traduit l’emprise des seigneurs sur le site
(Vallis
Guidonis, puis Laval). Une forteresse viendra compléter cet
ensemble défensif. Une autre forteresse est construite
à Montjean.
Les
rivalités
féodales qui opposent le compte du Maine, la maison d'Anjou
et
le duc de Normandie, et les guerres privées incessantes vont
marquer la fin du XIe siècle.
Naissance
de la Noblesse
Des bénéfices militaires avaient
été
établis par les Francs sous forme de récompense
viagère que les rois accordaient aux talents et aux services
de
leurs officiers.
L'hérédité
des places et des gouvernements
qui
commençe au milieu du IXè siècle, sous
Charles-le-Chauve, opère dans la monarchie un changement qui
éteint peu à peu l'ancien gouvernement politique.
Les
ducs, les comtes, les officiers d'un ordre inférieur,
profitent
de l'affaiblissement de l'autorité royale, rendent
héréditaires dans leurs familles, des titres
dont,
jusque-là, ils n'avaient joui que temporairement.
Ils usurpent également et les terres et la justice, en
s'érigeant eux-mêmes en seigneurs,
propriétaires
des lieux dont ils n'étaient que les magistrats militaires
et
civils.
Ce nouveau genre d'autorité dans l'État, ces
nouvelles seigneuries usurpées, donnent
naissance à la noblesse.
La France se trouve divisée en une infinité de
petites
seigneuries. II n'y a plus de lois communes à la nation
chaque
seigneur en fait de nouvelles dans son donjon.
Chaque
seigneur est roi dans ses domaines et ne reconnait d'autre
autorité que la sienne.
Bientôt
les rois n'ont plus d'autorité, ni sur les
comtes
qui obtiennent l'hérédité des fiefs,
ni sur les
évêques qui deviennent souverains chez eux comme
les
seigneurs.
Il
s'en suit un
morcellement des anciennes cités gallo-romaines en
seigneuries,
en vicomtés et en châtellenies. Les Seigneurs,
Vicomtes et
Châtelains se distinguent par leur importance et les
différents degrés de noblesse de leurs titres.
Jusqu'à
la
révolution française de 1789, le canton de BAIS
suivra les vicissitudes de l'abbaye
d'Évron
ou de la Chatellenerie d'Orthe
(à St Pierre sur Orthe).
Dans
les campagnes
Les
serfs et les roturiers ont beaucoup à souffrir des guerres
privées que se font les seigneurs, et des lourdes redevances
seigneuriales de toute nature auxquelles ils sont soumis.
Renaissance
féodale (1000/1350)
Croisades
Les
paysans et les
citadins se ressaisissent et l'on assiste à une renaissance
féodale : les hauts et puissants seigneurs
ramènent une
paix relative dans les campagnes
et dans les villes. Se heurtant de plus en plus à de solides
forteresses, les vikings cessent de piller et rançonner.
L'église s'efforce de réduire les
guerres entre
petits
nobles en proclamant la "paix de Dieu" au cours d'un
célèbre concile, à Charroux,
près de
Civray, en 989 et en les entraînant, plus tard, dans les
croisades
(URBAIN II en 1096). Quelques seigneurs de la Mayenne prirent la croix
pour aller délivrer Jérusalem.
C'est
à cette époque que les templiers et les
hospitaliers
créent les établissements de soins :
maison-dieu,
maladrerie, ladrereie, léproserie destinées
à
receuillir les victimes atteint de cette maladie rapportée de
l'orient (la Commanderie de Thévalles et le Breil-aux-francs
prés de Laval).
Au
grès
des
alliances, conquêtes et reconquêtes, le Maine est
rattaché à l'Anjou en 1126 puis au domaine
de France en 1203.
C'est une époque où les trouvères au Nord, comme les troubadours au Sud, rivalisent de talent
dans les cours des comtes et des rois.
En
1246, CHARLES
ler,
comte de Provence reçoit la jouissance du Maine en apanage
des
mains de Louis IX. C'est vers cette époque que l'on voit
s'établir dans le Maine, l'industrie
des toiles qui devra plus tard
l'enrichir.
Développement
des Abbayes
Les
abbayes qui
étaient le plus souvent de grands domaines, se
multiplient et s'enrichissent.
L'Abbaye cistercienne de la Roë (Chateau-Gontier) est
fondée en 1096
par
Robert d'Arbrissel, l'Abbaye de Bellebranche (Sud-Est de Laval) en
1150, l'Abbaye de
Clermont (à Olivet au Nord-Ouest de Laval) en 1152 par Saint
Bernard et l'abbaye de
Fontaine
Daniel
(prés de Mayenne) en 1204. La vie et l'habitat se sont
développés
autour de
ces abbayes, autour desquelles des défrichements successifs
ont
permis de fixer la population et de créer des paroisses, qui
existent encore aujourd'hui.
A Evron,
au XIIe
siècle, les bénédictins
élèvent la chapelle
Notre-Dame-de-l'Epine.
Aux XIIIe et XIVe
siècles, l'église d'Evron prend de l'ampleur : le
chœur, les chapelles de l'abside, le transept et la nef
gothique
sont construits par les religieux.

Notre
dame de l'épine
à Evron | 
Abbaye
de Clermont à Olivet
|

Abbaye
de la Roe à Chateau-Gontier | 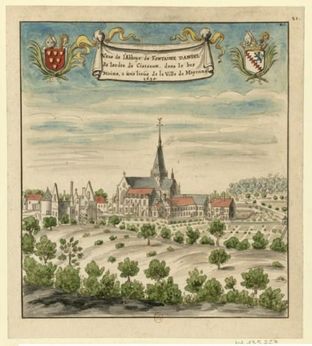
Abbaye
de Fontaine Daniel |
Des
écoles épiscopales sont
créées.
Maîtres d'œuvre et tailleurs de pierre
édifient les
plus belles églises de tous les temps : c'est le renouveau
de
l'art roman.
Les "églises granges" se trouvent
agrémentées de fresques. De nombreux
édifices
religieux s'ornent de peintures murales dont les plus remarquables dans
le chœur de st jean baptiste à
Château-Gontier.

Eglise
de Neau | Un
rare cycle consacré
à saint
Vigor, évêque de Bayeux, accompagne le Christ
présidant à la résurrection des morts.
Le
décor a été
réalisé peu après le milieu du XIIIe
siècle.
Si
aucun texte ne parle du
commanditaire, nous
disposons par contre de son "portrait" : Geoffroy de Bais
s’est
fait représenté, et nommé, dans
l’homme
ressuscitant sous la protection de la Vierge.
|
Entourées
de remparts, les villes défient les pillards et les soldats
en
rupture de bans. Elles obtiennent du pouvoir central la garantie de
leurs coutumes et de leurs privilèges. Elles se peuplent
d'artisans
: charpentiers, bouchers, tanneurs, tonneliers qui ont
laissés leurs noms à de vieilles rues. Le
commerce
par bateau
est plus développé que le transport sur des
routes
restées médiocres. Les villes essaiment dans les
faubourgs.
Développement
des
châteaux forts et forteresses
A
Laval,
alliés successivement aux familles nobles de Normandie, de
Bretagne et d’Anjou, les seigneurs de Laval
contrôlent,
dès le XIe siècle, les
hauteurs de la rive
droite et la traversée à gué de la
Mayenne.
Dés 1020, Guy 1er de Laval est chargé, par les
comtes du
Maine et d'Anjou, d'établir une forteresse
pour contrôler le gué sur la rivière.
Agrandi, élargi, il se dote à la fin du XIIe
siècle de son donjon
qui domine fièrement la vallée de la Mayenne.
Au XIIIe siècle, un pont
de pierre
est bâti pour franchir la Mayenne. Il restera,
jusqu'à la
Révolution, la voie de passage obligée entre
Rennes et Le
Mans.
A Bais,
blotti au
pied du Montaigu, le château
de Montesson est construit au
XIVe. L'édifice
fut fortifié à la fin du XVIe siècle
et
doté d'un remarquable pavillon d'entrée avec une
tour en
forme de bulbe, couverte d'ardoise et d'inspiration polonaise.
Une
floraison de château forts et forteresses voient le jour :
- Au XIIIe siècle : le château de Clivoy
à Chailland, la château de Villiers,
- Au XIVe siècle : le château de Goué
à
Fougerolles du plessis, Bois-du-maine à Rennes en
Grenouille, St
Thomas-de-Courceriers, le château des écottais
à
Jublains, le château de Loré à
Oisseau, le
château de la Rongère, le château de
Monteclerc
à Chartres la forêt, Ambrières,
Domfront...
 | 
Château
Bois-du-Maine à Rennes
en Grenouille |

Château
de Monteclerc à Chartes la forêt |

Château
de Montesson
à Bais |
Dans
les
campagnes
Les guerres privées sont
beaucoup moins
nombreuses, du fait des croisades, ce qui profite aux
campagnes.
Les
épaisses
forêts du Bas Maine où sont venus se
réfugier les
ermites vont être considérablement amoindries par
la
poussée du peuplement. De nouveaux bourgs, des fermes se
créent. L'essentiel des
hameaux et bourgades se mets en
place au
XIe et sera quasiment définitive au XIIIe.
Ces
hameaux sont
autant
de points de fixation où marchand et artisans s'installent
et
où foires et marchés s'organisent
et intensifient
le
courant des échanges, où le textile occupe
déjà une grande place.
Un
ensemble de
découvertes
importante vont être faites. La charrue
en premier lieu est une révolution puisque son usage permet
de
multiplier les rendements par 2 (3 à 4 grains pour un).
Contrairement à l'araire qui se contente de creuser la
terre, la
charrue grâce à son versoir renverse la terre
remontant en
surface la terre la plus fertile.
A
cela, il faut
ajouter l'assolement
triennal
(une année céréale d'hiver, une
année
céréale d'été, une
année
jachère), l'utilisation de la herse,
la pratique du marnage
(ajout de roche argileuse) et du
chaulage (ajout de chaux). A cela, il
faut ajouter le collier
rigide pour les chevaux
qui permet de multiplier par 10 la force de traction.
Enfin,
le moulin
à eau
apporte également une petite révolution technique
et connaît un essor considérable.
Le
monde agricole
connaît une réelle amélioration de la
production :
les rendements vont jusqu'à 7 pour 1 (froment) et 9 pour 1
(avoine). Le seigle, le froment et la vigne occupent une grande place
dans la production.
Les
comtes et
vicomtes,
partis chercher une vaine gloire en terre d'orient, en
ramène de
nouvelles plantes : le safran dans le Gâtinais, le
réglisse en Anjou et le
sarrasin dans le Maine.
De plus, les croisades, nécessitant de nombreuses
rentrées d'argent , ont obligé certains seigneur
à
vendre une partie de leurs terres. Occasion pour le paysan de changer
de maître, voire de devenir
propriétaire. Béatrix
de Gâvre, épouse de Guy de Laval, originaire
des Flandres, fait venir de son pays des ouvriers tisserands
qui introduisent et perfectionnent le tissage des toiles
de lin dans
le comté de Laval.
Ces
progrès ne doivent pas faire oublier que le
petit
paysan,
trop pauvre pour acquérir les nouveaux outils, en
bénéficie peu : la plupart sont des "laboureurs
à
bras", ce qui exclut cheval et charrue. Le servage recule mais ne
change rien à la pauvreté du paysan.
La
guerre de cent ans (1350/1450)
Les
prétentions
des anglais envers les terres de France provoquent des combats, en
fonction des alliances des nobles à la couronne
française
ou anglaise. Cette guerre se généralise et gagne
le Bas
Maine dés 1356, année de captivité du
roi Jean II
le bon par les anglais.
La
guerre durera
jusqu'en 1450 environ. Succession de batailles serrées, de
conquêtes, de défaites, d'embuscades, pillages,
elle désole le
Maine pendant 100 ans.
Après
des
pillages, une
première occupation
de Mayenne par les anglais dure 3 ans de
1361 à 1364.
En 1370, Du Gesclin, installé au château de
Montsûrs, obtient le repli des anglais du Maine avec son
ami Guy XII, baron de Laval qui se distingue à ses
cotés dans les batailles de Cocherel (1364) et Pontvallain
(1370). Il doit lutter également contre les
compagnies
(mercenaires),
véritable
fléaux quand ils ne sont pas engagés par une
armée. En 1368, elles s'emparèrent de
Château-Gontier et l'occupèrent pendant un an. En
1379,
d'autres aventuriers, anglais, séjournèrent
quatres jours
à Cossé-le-vivien et y commirent de nombreuses
dévastations.
Aprés
la mort de Du Gesclin, et appelés par le duc de Bretagne, les
anglais dévastent l'ouest du département
(Saint-Pierre-sur-erve, Entrammes, Cossé-le-vivien, La
Gravelle...) mais sont repoussés par Guy II.
Aprés
la défaite d'Azincourt, une
nouvelle offensive a lieu qui est repoussée par
Ambroise de
Loré (à Villaines-le-Juhel en 1419) et
André de
Laval-Lohéac. Une victoire éclatante sur des
troupes
anglaise de passage, la bataille de la Brossinière,
à
Bourgon, va même marquer l'année 1423.
Pourtant,
une
deuxième occupation anglaise a
lieu au milieu du XVe siècle : Le
Mans, Mayenne sont
occupés par les anglais de
1425
à 1448;
Sainte Suzanne est prise par le comte de Salisburry, grâce
à son artillerie, face à Ambroise de
Loré. Pendant
cette occupation, Jean de Bedfort gouverne, en qualité de
comte,
le Maine et le Perche. Laval et Sillé résistent,
tant
bien que mal, aux anglais (Laval est occupée un an avant
d'être libéré graçe
à un meunier Jean
Fouquet qui fit entrer 400 soldats par son moulin en 1429).
Ambroise
de
Loré
reste maître de Saint-Céneric mais
reçoit l'ordre
de rejoindre Jeanne devant Orléans, puis part à
Caen
où il fait 3000 prisonniers. Charles VII, reconnaissant le
nomme, pour le récompenser, prévôt de
Paris et de
baronnie Laval
est érigée en comté
(1429).
Pillages
et
épidémies
Pendant
cette
période
troublée, les campagnes souffrent des pillages
et ravages de la guerre,
qui sont le fait des troupes ennemis mais aussi des troupes
amis,
quand ce ne sont pas des bandes de brigands. Ces groupes
armés
font table rase, récoltes et manants compris. De
lourdes contributions (impots, certificat, sauf-conduit..) sont
demandées aux populations par les troupes d'occupation. A
ces
fléaux vient s'ajouter l' épidémie
de peste de 1450 qui
décime la population.
La
population des
campagnes est gravement touchée et affaiblie. A
la fin
de la guerre de cent ans, alors recensée au nombre de feux,
elle
a diminué de moitié. De nombreux champs
retournent en
broussailles puis en taillis et forêts. De nombreuses
régions souffrent de la famine. Une migration a lieu qui
voient
les bretons partir vers des régions plus paisibles : nord,
bassin parisien ou Picardie.
Les
Guerres de religion (1450/1600)
La
paix
retrouvée
laisse le Bas Maine dans un état désastreux. Une
durable
période de calme va permettre au bas Maine de se relever de
ses
ruines, avant de nouveaux les guerres de religion.
En
1481, la ville de
Mayenne
échut au duc René II de Lorraine. A sa mort en
1508, la
branche cadette des célèbres duc de Guise
hérite
de la baronnie de Mayenne et la fait ériger en marquisat en
1544, puis en Duché
en 1573, en faveur de Charles, le célèbre
adversaire d'Henri IV, le chef de la Sainte Ligue,
que l'histoire connaît d'ailleurs sous le nom de Duc
de Mayenne. La ville de
Mayenne fortifie ses accès pour suppléer aux
remparts qui ne furent jamais construits.
En
1481, la mort de
Charles II d'Anjou, comte du Maine, permet à Louis XI de
rattacher le Maine au domaine royal. Le comté du Maine
devient
une subdivision de la généralité de
Tours.
Protestantisme
et
Réforme (1536-1598)
En
1526 a lieu la
première
manifestation de la réforme à Laval.
En
1536, les protestants sont expulsés de la ville et leurs
biens confisqués. De 1546 à 1548, les
hérétiques (Jean
BATAILLE, Grandami...) sont brûlés
sur la place publique.
En 1560, l'église réformée est
autorisée à prêcher son
culte. En
1562, les protestants s'emparent du château neuf de Craon et
ravagent
ses environs. En 1568, c'est la ville de
Château-Gontier qui subit
leurs saccages. Aprés la saint
Barthélémy (1572), les seigneurs de
Laval, ardents Huguenots, sont forcés de quitter la
France pendant
quelques temps.
Le
Protestantisme
est
prêché au Mans
par HENRI DE SALVERT, en 1559, et ensuite par MERLIN, de Paris, qui
parvient à convertir un grand nombre de Manceaux. Le
clergé, de son coté mène une
contre-réforme
en opposition
à la prolifération du protestantisme.
Une
lutte s'engage bientôt entre les catholiques et les
protestants et le Maine est le théâtre d'une
guerre
horrible qui finit par l'extermination
des protestants.
Le Mans et les principales places de la province sont au pouvoir des
Ligueurs quand HENRI
IV s'en empare en
1589.
A
Mayenne,
les troupes de la Ligue se resaisissent du château
à
deux
reprises, en avril 1590 et en juin-juillet 1592. Le 29 juillet, Henri
IV envoie le prince de Conti devant la cité, qui se rend
"avec
les honneurs de la guerre" le 14 août. C'est au cours de ce
siège que le château fut en grande partie
démantelé par l'artillerie royale.
Après tous ces changements de main, la ville de Mayenne va
enfin
pouvoir panser ses blessures dans la paix religieuse
rétablie.
En
1592, le nord du département (Erné, Gorron,
Ambrières, Mayenne) est également
pillé par les
anglais, envoyés par la reine d'Angleterre en soutien au roi
de
Navarre, tandis qu'au sud, le Craonnais est de nouveau
ravagé par les ligueurs. La
pacification n'a vraiment
lieu qu'avec l'édit de
NANTES en 1598, autorisant les temples protestants. Les fortifications
de Craon, avec ses 25 tours, sont
démentelées.
Aristocratie terrienne
Une
transformation de la
campagne est
amorcée par l'aristocratie
de gentilshommes,
propriétaires de terrains de 40 à 80 hectares,
qui bâtissent
des manoirs :
le château de l'Orgerie (forêt de Pail), La
Vaudelle
(Trans), Château de Chelè (Hambers),
Château de
Neuvillette (Jublains), Château de Thiré (La
Bazoges), La
cour de Grazay, Le Rocher (Mézangers), Château de
Soulgé (Saulges)...
Edifié
au XVe, le
château d'Aron montre l'effort des aristocrates pour le
développement des grosses
forges en partie
graçe aux mines de fer présentes en Mayenne :
à lire
Le
Château
d'ARON et ses grosses forges
d' A. GROSSE-DUPERON.
De
la même époque,
on découvrira un extrait du patois : la
légende de TREHOUDY (Aron)

Château
de Saint-Ouen à
Chémazé
| 
Château de la
Vaudelle à Trans | 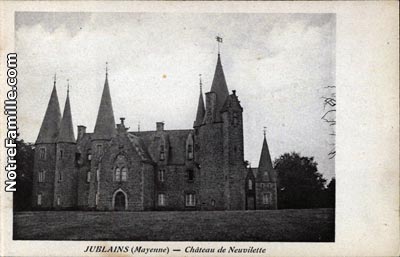 |
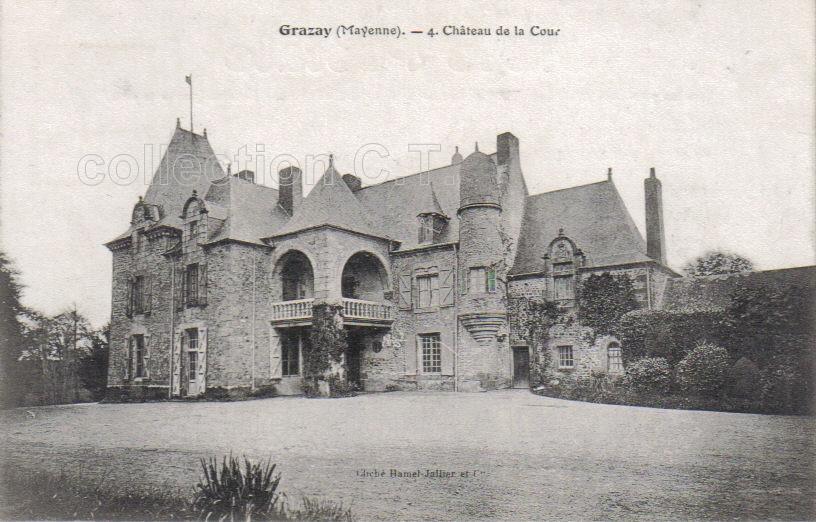
Château de Thiré à la Bazoges | 
Château
du rocher
à Mézanger | 
Château de Soulgé à Saulges |
A
la
campagneLe
développement de la bourgeoisie amène le
développement du
commerce
et de
l'industrie.
Le
lin
et le
chanvre
figurent parmi les oblations faites à l'église,
à la fin du XVIe s.
Les
échanges commerciaux de la France avec les riverains de la
mer noire permettent le développement du sarrasin,
cultivé désormais au même titre que le
seigle
ou l'
avoine.
La
pomme
vient supplanter la vigne. Le vin, de médiocre
qualité,
est abandonné au profit de vin importé ou de
cidre
produit sur place. Ce mouvement est accentué par les fortes
gelées de 1493.
à lire :
Le
cidre : son introduction dans le pays de Laval
de l'abbé Angot.
Le
calme du
début
du XVe siècle permet un renouveau de l'agriculture, qui
disparaît dans les guerres de religions. Sous
le règne de François 1er, la Mayenne est rendue
navigable de Château-Gontier à Laval. La
chapelle
Saint-Michel ainsi qu'un
ermitage sont édifiés au XVeme siècle
sur le Montaigu.
Les
frondeurs mis
à mal se
vengent en
pillant les campagnes.
A l'issu des guerres, les biens sont dévastés:
ponts
détruits, chemin encombrés de ronce, biens
pillés.
De plus, le climat
est
particulièrement rigoureux en 1556, 1566, 1580, 1593 et
1608. De
nouvelle
épidémie de
peste
ravagent le Maine en 1469, 1472, 1480 et 1580.
Pendant
les années 1473, 1482 et celles qui suivent, les
récoltes
sont
mauvaises, entrainant un prix trés
élevé du pain
et des famines. Pour combattre la
famine, la farine de sarrasin est
mélangée avec des racines de fougère
ou des
glands.
Le
temps des rois et du
renouveau économique (1600/1700)
Le
Maine redevenu
tranquille, la
paix royale s'installe.
Elle profite surtout aux villes où elle favorise le
développement du commerce et de l'industrie,
de
l'artisanat
et permet à sa population de se consacrer aux
études et
à la grande noblesse d'accéder aux plaisirs de la
cour.
En un demi-siècle, les ravages des guerres sont
réparés.
Mayenne
A
la mort du
célèbre Duc de Mayenne, en 1611, son fils Henri
devient
le 2ème Duc de Mayenne mais meurt en 1621 sans laisser de
descendants. Le duché passe alors par sa soeur à
une
autre grande famille, les Gonzague, ducs de
Mantoue et de Nevers.
Sous leur influence, la cité de
Mayenne prend parti
pour la Fronde (soulèvement contre Mazarin) sans subir, il
est
vrai, de troubles sérieux. Enfin, en 1654, le tout puissant Cardinal
Mazarin,
redevenu Premier Ministre, achète Mayenne à son
duc,
Charles IV de Gonzague, mettant ainsi un terme définitif au
rôle militaire de son château, réduit
à
être désormais la résidence
très
épisodique de ses seigneurs.
Le premier soin de Mazarin fut d'envoyer à Mayenne
son
intendant, Colbert,
qui y séjourna longuement en 1656 et décrit
à son arrivée Mayenne en termes peu flatteurs
"la
ville est
très sale et très vilaine, le peuple
méchant".
Sans délai, Colbert déploie
l'intelligence et
l'inlassable activité qui devait faire sa gloire. Il fait
entreprendre de grands travaux d'assainissement
et d'urbanisme
: assèchement des deux étangs de Beaudais,
construction
du château des Buttes, connu sous le nom de "Grand Logis"
pour
servir de résidence aux ducs à la place du vieux
château fort trop délabré et
inconfortable.
Il dote Mayenne d'une municipalité et d'une Barre
Ducale
siégeant au "Palais" qui est maintenant l'Hôtel de
Ville.
De plus, les nouveaux offices créés vont
contribuer au
rayonnement et à l'essor de la ville en y fixant toute une
série de familles de noblesse de robe et de bourgeoisie
qui se firent construire, au cours des XVIIème et
XVIIIème siècles, l'ensemble d'hôtels
particuliers
qui encadrent les places Haute et Basse du Palais (de nos jours places
Cheverus et Louis de Hercé).
Durant
130 ans, la
cité de
Mayenne va connaître le calme et une
prospérité basée sur le tissage
et le négoce des toiles de lin
cultivés dans tout le Bassin Maine. Par contre, les ducs
résidant à la Cour vont se faire de plus en plus
rares
sur leur fief. Après la famille Mazarin-La Meilleraye, la
seigneurie de Mayenne va changer de famille à chaque
génération par alliance : Durfort
en 1735,
d'Aumont en 1747, Grimaldi de Monaco en 1777. C'est ainsi que de nos
jours, le prince Rainier III de Monaco porte toujours le titre
féodal de Duc de Mayenne.
Au
crépuscule de
l'ancien régime, Mayenne était une
cité
considérable, presqu'autant que Laval, peuplée
d'après le chanoine Le Paige, de 9 900 communiants (soit
près de 12 000 habitants). A n'en pas douter elle aurait
paru au
touriste contemporain une bien pittoresque agglomération
avec
l'engagement de ses
toits à poivrières descendant jusqu'à
la rivière bordée de vieux moulin à
roues
et dominée par les remparts encore imposant de son vieux
château et les rochers de ses deux paroisses et des chapelles
de
deux importants monastères : celui des Calvairiennes (actuel
lycée Sévigné) et celui des Capucins,
futur
couvent de la Visitation.
A
lire : le compte-rendu
de la dame d'Aron au cardinal de MAZARIN
sur ses propriétés et ses droits.
Développement
du commerce
Au
Mans, en 1600,
HALLAI
établit la première fabrique de bougies. Quelques
années après, JEAN Véron (1615-1689)
invente les
étamines camelotées (nouvelles étoffes
de laine plus fines) qui font bientôt
l'objet d'un
grand commerce.
Les fabriques de toiles
de Laval
(fabriquées également à Mayenne et
Château-Gontier) prennent aussi une
grande extension et avec elles, la
culture et le travail du lin .
Développement
des arts et des sciences
La
bourgeoisie
développe les
arts et les sciences et plusieurs Manceaux se sont illustrés
:
- GERMAIN PILON père, et surtout GERMAIN PILON (1528-1590)
son fils,
peuvent
être considérés comme les fondateurs de
la
sculpture française,
- PIERRE BELON (1517-1564), savant naturaliste, fit des voyages en
Grèce, en
Arabie, en Égypte, et en rapporta des plantes utiles et
rares,
- AMBROISE PARÉ (1510-1590) est appelé le
père de
la chirurgie,
- RONSARD (1524-1585) fut l'un des meilleurs poètes de son
temps.
A
Laval, la contre-réforme
donne l’occasion aux artistes locaux de diffuser le
modèle
du retable lavallois
dans toutes les églises de l’ouest, faisant ainsi
oublier
l’engagement des seigneurs de Laval dans le parti protestant.
La révocation de l'édit de Nantes de 1685 (par
Louis XIV !) n'a pas
de conséquence en Mayenne où les rares
protestants préfèrent se convertir
plutôt que fuir, à l'exception de quelques rares
nobles.
La
campagne connaît encore des famines
Sous
l'influence des
italiens, nombreux à la cour de Valois et par suite de la
découverte de l'Amérique, de nouvelles plantes
font
leur apparition dans le Maine :
tomates,
melons, mûriers
(en Touraine pour le ver à soie). Le
dindon
se mêle aux poules et aux canards dans les
basses-cours.
Ces
mesures favorisent une renaissance des campagnes qui s'accompagne d'un
accroissement d'une population très active.
Les
guerres (dite de "30 ans") de
Louis
XIV (1643-1715) enlèvent beaucoup de
bras
à l'agriculture ce qui provoque un abandon des terres en
landes
(les champs sont "ensemençés" de genets qui sont
brulées au bout de 5, 8,
10 ans
!) et entrainent de médiocres
récoltes.
Comprenant
que la
majorité des paysans est écrasée par
le poids des impôts
royaux et seigneuriaux,
Colbert
prend
des mesures pour atténuer ces dettes et commence un
vaste
programme de
développement de l'élevage : il
interdit de
saisir le
bétail pour
la taille (1663) ou pour dettes (1667). L'élevage,
en cette
fin du
XVIIe siècle, est encore peu prisé par la
majorité
des paysans : les bestiaux sont vendus maigres aux herbagers
normands qui les engraissent. Des boeufs et des porcs gras sont vendus
à Paris. L'importation
et l'exportation de blé sont
réglementés par
l'état (1669-1683). Le
seigle,
l'
avoine et le
sarrasin
restent
cependant les principales céréales
cultivées,
complétées par le
lin,
le
chanvre et les
chataignes.
Malheureusement,
cela
ne fait pas reculer la famine qui frappe les campagnes de
façon
endémique depuis les guerres. Dans le Bas Maine, la
famine
touche le peuple en 1624/26, 1636/41, 1649/50, 1682, 1693/94 et
1699/70.
La vie des paysans reste
misérable, si l'on en
croit
les récits de Fénelon et Vauban. L'hiver
de 1709
fut tellement rude qu'il fut appelé le "Grand
Hiver". En
1716, les loups en bande nombreuses sortent des bois et vont
jusqu'à s'attaquer aux hommes.
1ere
Révolution agricole (1700/1789)
Dés
1752,
les
portes des villes de Laval et du Mans ne sont plus fermées.
Un
pouvoir politique central fort permet le développement
des transports et de l'économie.
L'amélioration
des moyens de transport
Le
trafic entre les
villes et vers
l'atlantique s'accroît. Les intendants du XVIIIe
siècle tracent de belles
routes droites et larges,
de Paris vers Le Mans entre autres. De lourds chariots et d'amples
diligences y effectuent des étapes de 20 à 30 km
par
demi-journée de trajet.
En Mayenne, il n'y a pas
de routes
mais
des chemins étroits où les marchandises sont
transportées à dos d'hommes ou d'animaux. Les
premières routes apparaissent sous Louis XV (1715-1774) et
donneront nos nationnales. Cela
n'empêche pas le développement important du
commerce.
Le
transport fluvial
n'est pas en reste qui voit apparaître un trafic
d'importation de
sel (atlantique), de hareng (hollande), de sucre (Antilles), de Tissus
de laine et de coton (Angleterre). En retour, on expédie le
vin
et le blé (vers les iles), les salaisons et les articles de
ménage.
L'aménagement
des
routes royales et l'apparition de la concurrence font
apparaître
les premières difficultés dans les forges et la
manufacture du Maine.
Laval
Le
XVIIIe
siècle marque l’apogée
économique
d’une ville toute entière tournée vers
le textile
et dirigée de fait par une oligarchie
de marchands vivant dans de
somptueux hôtels particuliers.
Les toiles de Laval font l'objet d'un commerce
actif vers le nouveau monde
dès la renaissance. En 1768 Laval compte 15 blanchisseries,
90
000 personnes travaillent pour celles-ci dans le Bas Maine. En 1780, on
produit plus de 30 000 pièces de toiles que l'on
étend
pour les blanchir, sur des piquets fichés dans les prairies
de
la rive gauche.
Sur les hauteurs se construisent de vastes
hôtels particuliers de granit et de tuffeau.
A l'opposé, dans les faubourgs, de petites maisons
dotées
de grandes caves (pour garder le lin humide) abritent les ouvriers et
leur métier à tisser.
La révolution vient interrompre ce cycle de croissance
économique. La ville voit passer les armées
républicaines et vendéennes. Les chouans tiennent
la
campagne.
A
lire Histoire
de l'imprimerie à Château-Gontier
René Gadbin
La
vie à la campagne
"A
la fin du XVIIIe
s. le froment
était si rare, que M. Foucault de Vauguyon, curé
d' Ahuillé
de 1755 à 1780, était obligé d'en
acheter pour se
nourrir, la dîme ne lui suffisant pas.
Déjà
sous son successeur, le froment était plus
cultivé que
l'avoine." <dictionnaire de l'abbé Angot>
En
1776,
l'édit
de Turgot affranchie de la taille (paiement d'un impôt au
seigneur) toute terre mise en culture. Des milliers
d'arpents sont gagnés sur les landes.
Sous
le
règne de
Louis XVI,
l'introduction de la
pomme
de terre,
utilisée d'abord comme aliment pour le bétail,
met fin
aux disettes dans la Bas Maine. La
betterave
gagne également
du
terrain.
Le
matériel
agricole reste primitif :
on scie le blé mûr à la faucille, on
utilise les
fléau pour dépiquer les
céréales.
Cependant,
s'inspirant
des
fermiers anglais,
certains gentilshommes campagnards et quelques
paysans aisés introduisent et expérimentent une
"
agriculture
nouvelle". Les pratiques agricoles vont très
progressivement
s'améliorer et se généraliser avec
pour
conséquence une amélioration des rendements qui
s'amorce
dés 1750.
La
pratique
du
chaulage
et la culture des
légumineuses sont introduits
avec pour
objectif de supprimer la jachère. L'
achat
de semence est
recommandé plutôt que la réutilisation
des
mêmes semences d'une année à l'autre.
L'
assolement
triennal (céréale d'hiver +
céréale d'été +
légumineuse) avec utilisation des
amendements
(gypse, sulfate... selon le sol) et du
fumier
sont mis au
point en remplacement de la jachère. Sont introduits
également les
labours
multiples et profonds, les
plantes
fourragères (aliment pour le
bétail), les
prairies
artificielles (terrain en herbe moins de 5 ans) et les
machines
agricoles ancêtres de nos semoirs,
moissonneuses, et
batteuses.
Sans
doute ces
progrès ont bénéficié d'un
mouvement
intellectuel, prés du pouvoir, de "physiocrates" qui
considèrent l'agriculture comme seule véritable
richesse
et qui veulent l'élever au 1er rang.
Cependant,
les
paysans
jugeant d'un œil critique ces innovations ou n'ayant pas les
moyens de les mettre en œuvre, vont mettre plusieurs
décennies avant de les appliquer pour en tirer tous les
bénéfices.
La
situation sociale
du
paysan n'a pas évolué. En France, sur 28 Millions
d'habitants, les paysans sont 22 Millions et possèdent 50 %
de
la surface cultivée. Sachant que de gros
propriétaires
possèdent la plus part des terres, la majorité
des
paysans sont propriétaires d'un lopin de terre de un ou deux
hectares, d'une masure et vendent leurs services aux grosses
exploitations ou louent des terres vacantes en reversant la
moitié des récoltes au propriétaire.
Les
paysans
sont
taillables (imposables)
jusqu'en 1776 et
corvéables
(travail gratuit
du
au noble) jusqu'à la révolution qui fait
disparaitre également le
champart
(part de
récolte reversée au noble) et les
banalités
(usage
obligatoire, et rémunéré, des
outils du
seigneur : moulin, forge, pressoir...).
La
vie
matérielle
des paysans du XVIIIe reste médiocre même si elle
s'améliore sensiblement. Les habitats sont des
chaumières
à simple rez-de-chaussée et au sol de terre
battue.
Vêtu de gros drap de laine et de linge en toile de chanvre,
hiver
comme été, on va pieds nus, sauf pour assister
aux
offices religieux.
Pendant l'hiver 1788-1789,
beaucoup de personnes meurent de faim et de froid et la
révolte gronde
dans les campagnes. Louis
XVI sensible à cette misère, organise les
états
généraux du 5 mai 1789 : les Mayennais
envoient
à Versailles 3 députés pour la
Noblesse, 3 pour le
clergé et 7 pour le tiers-états.
Chaque région, chacune dans un patois
différent, exprime les mêmes doléances
: abolition des
privilèges, peur de la disette...
A
lire de Em.-Louis
CHAMBOIS-
Observations
de météorologie populaire au Maine
Révolution
française
et chouannerie (1789/1816)
Pendant
la révolution, la prise de la bastille est acceuillie avec
la
plus grande joie, tandis que des milices s'organisent dans toutes les
villes par peur des troubles.
Les 23 et
24 Juillet, le toscin
sonne suite à des tumeurs sur des brigandages : ces jours
seront
appelés le "Jeudi et Vendredi fous". Le 4 aout et
l'abolition des privilèges mets fin aux attaques ponctuelles
de
châteaux par les paysans.
En
1790,
l'Assemblée Constituante modifie profondément
l’organisation administrative du Maine. Cette province
disparaît pour faire place à deux
départements :
celui de la Mayenne,
avec Laval pour chef-lieu, et celui de la Sarthe,
chef-lieu Le Mans. Dans ce découpage, la Mayenne est issue
du
regroupement des paroisses qui cultivent ou filent le lin.
La
constitution civile du clergé avec la vente de
biens de
l'église et le serment (ou la fuite des prêtres)
mets fin
à la liesse qui accompagne la révolution
jusqu'alors. La
levée de volontaire pour défendre la patrie se
passe bien
en 1791 mais donne lieu à quelques troubles en 1792. De
plus, la
Révolution Française a laissé des
traces visibles
encore aujourd'hui en créant un clivage entre Chouannerie et
République qui a pratiquement perduré
jusqu'à la
Vème République. Il est renforcé par
un
découpage administratif qui concorde avec le clivage
politique
du Bas Maine : la Mayenne Chouanne d'un coté, la Sarthe
républicaine de l'autre.
La
terreur
A partir du 1e octobre
1793, la guillotine parcourt les
principales
villes du département et va
envoyer 500 personnes à
l'échafaud.
La
guerre
des
vendéens
En octobre 1793, les paysans Vendéens s'insurgent
contre les
décrets de la convention, et en particulier la convention
civile du clergé. C'est un mélange
complexe de
catholique en opposition aux philosophes du XVIIIe siècle,
de
campagnards contre les citadins, de nobles contre les bourgeois et
même de jeune gens contre le service militaire
décrié.
Cette opposition est la dernière manifestation
d'un
régime rural basé sur le pouvoir d'une noblesse
et d'un
clergé local laissant la place à un pouvoir
bourgeois, citadin et laïque.
Les
vendéens,
revenant de Granville, s'emparent de Laval, de La Flèche
puis du
Mans où ils livrent la ville au pillage. Jean CHOUAN et ses
400
hommes rejoignent les vendéens (Jean Chouan trouvera la mort
en
1794 mais son mouvement continue en portant son nom). Les chouans gagne
l'attaque de la lande de la Croix-Bataille, en octobre
1793.
L'armée
républicaine riposte : elle pénètre
au Mans
et après deux jours de résistance (12/13
déc.
1793), les Vendéens se retirent vers Laval pour
être
défaits un peu plus tard à Savenay en
décembre
1793. Le massacre de 15.000
chouans
et vendéens au Mans, puis du reste de l'armée
vendéenne à Savenay, marque tragiquement la fin
d'un
épisode des guerres de Vendée: la
virée
de Galerne.
La
guérilla des
chouans
Les débris de l'armée
vendéenne se jettent
dans le parti des Chouans. Ceux-ci, au lieu de combattre comme les
Vendéens, par grandes masses, s'éparpillent dans
les bois
et s'appliquent à détruire en détail
les
armées républicaines (1795).
HOCHE inflige aux Chouans plusieurs défaites sans
pouvoir
les
réduire complètement. Mais, en 1797, à
la
tête d'une armée de 35.000 hommes, il leur fait
déposer les armes dans les départements de la
Sarthe, la
Mayenne, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, l'Orne et
le
Calvados.
En 1799, après deux années de paix apparente, les
bandes
se reforment et 1.500 Chouans commandés par de BOURMONT,
sous le nom de "Mécontents",
s'emparent par surprise de la ville du Mans, le 14 octobre et la pillent et
la rançonnent pendant trois jours.
Sur ces entrefaites, le Directoire est renversé
par Bonaparte
qui envoie le général BROME avec 30.000 hommes,
La guerre civile est alors promptement terminée. En
1814, à la nouvelle du retour de Napoléon, les
chouans
reprirent les armes prés de Château-Gontier, Craon
et
Cossé-le-vivien avant de les déposer
aprés la
défaite de Waterloo.
A
lire
également : La
passion de Perrine Dugué (st suzanne) , La
croix de pierre
A
Mayenne
La
révolution est
d'abord bien accueillie par la majorité de la Bourgeoisie
Mayennaise, qui pense pouvoir accéder, dans la vie politique
et
administrative, aux rangs et aux places que lui méritent son
labeur et ses élites. Quand la constituante crée
les
départements en 1790, Mayenne veut faire valoir sa
proximité de Paris et son rang d'antique duché
pour
devenir le chef-lieu du nouveau département et c'est une
véritable
émeute
qui tente de s'opposer au passage du drapeau tricolore que
l'Assemblée envoie à Laval.
L'adoption de la constitution
civile du Clergé met le feu aux poudres
: le clergé de Saint-Martin ayant prêté
le serment
le 20 février 1791, tous ses paroissiens vont
désormais
suivre les offices de Notre-Dame. Les Capucins si
dévoués
et les pieuses Calvairiennes très populaires, sont
dispersés par la force, puis ce sont les prêtres
insermentés qui, à leur tour, sont
déportés
ou réduits à la clandestinité et les
églises fermées.
La révolte
populaire
éclate pour la première fois le 1er mars 1793.
Alexandre
Billard de Vaux, à la tête de 600 "gars"
décidés, tente un coup de main sur Mayenne. La
répression est brutale : Mayenne est livrée
à un
comité de surveillance révolutionnaire qui, sous
l'impulsion d'Esnue-Lavallée, fait régner une
terreur
sanguinaire, remplit les
prisons et pourvoit la guillotine installée place de
L'égalité (actuelle place de Cheverus).
La
"Grande
Armée"
des Vendéens, en route pour Granville, ne fait que passer
les 2
et 3 novembre 1793 et à nouveau le 25 novembre. Par contre,
dans
les campagnes environnantes, l'insurrection
générale se poursuit pendant 7 ans
et la première république ne peut venir
à bout de
la guérilla, souvent défaite, jamais
détruite, que
lui mènent les paysans révoltés sous
le nom de
"Chouannerie". Ce n'est qu'en rappelant les "bons prêtres",
en
rouvrant les églises et en promettant l'amnistie et la
liberté de conscience que le Consulat vient à
bout des
insurgés en 1800 et réalise la pacification
définitive du pays.
A Laval
L'instauration
d'une
administration préfectorale à Laval, change le
destin de
ce qui est désormais le chef lieu du département
de La
Mayenne. Le 1er préfet, Nicolas Harmand fait construire une
préfecture de style néo-classique.
Au
Mans
Pendant
la
Révolution, les Manceaux suivent le mouvement
général et le parti républicain compte
bientôt un grand nombre de partisans.
La
révolution française
Une
des
premières
décision prise est la confiscation
des biens du clergé,
entre autres les écoles catholiques (plus de 300 en
Mayenne).
Les instituteurs (laïques ou religieux) doivent
prêter
serments pour continuer à exercer et recevoir un salaire. La
majorité s'y refuse et beaucoup
d'école doivent fermer
par manque d'instituteurs. (voir document de l'abbé Angot La
Révolution et l'instruction populaire dans le
département de la Mayenne)
A
la campagne
La
révolution
libère la terre des cens et des rentes, sans changer
notablement
les structures foncières et agraires. Seulement, les anciens
tenanciers n'ont plus à payer la dîme au
curé et la
rente au seigneur. Cet allègement des charges n'a pas
d'impact
sur l'agriculture avant le second empire. Le paysan n'est plus soumis
aux corvées.
Les
progrès
techniques restent très lents : on continue
à
pratiquer
un assolement à base de céréales et de
jachère. L'élevage reste médiocre avec
des races
bovines rustiques mais de faible rendement en viande, en lait et en
travail. On élève plutôt du petit
bétail :
moutons, porcs, ânes et volailles,
qui s'accommodent d'une
nourriture frugale.
Pour labourer, le paysan ne
dispose que de l'araire à un
mancheron, ou d'une charrue à deux roues. Ils ne peuvent pas
pénétrer profondément dans le sol pour
défricher, d'autant qu'ils sont attelés
à des
bœufs de petite taille.
On utilise comme engrais le fumier
des
cours et des étables, aussi les rendements sont ils faibles.
La
population rurale
est
en hausse, l'immigration vers les villes est encore rare. Le paysan de
1848 est sans doute plus pauvre que son grand-père de 1788.
Faute de moyen de communication, on vend peu.
Chaque
famille vit sur
les produits de la ferme, achetant peu et vendant peu. De plus, avec le
régime de la propriété, fermage ou
métayage, une part des bénéfices de
l'agriculture
est aspirée vers les villes où
résident les
propriétaires des sols.
Enfin,
la
période
de trouble durant la révolution qui durera 10 dix ans, les
réquisitions de
récoltes et la surveillance
des
productions n'incitent pas le paysan à
investir. En 1793 la
levée des hommes pour la défense de la patrie et
en 1798,
la conscription avec un service
militaire de 5 ans privent la terre de
milliers d'hommes. En 1813, la France compte plus de 1.4 millions de
conscrits !
Les
préfets signalent
l'état déplorable des chaumières dans
le Bas Maine.
Restauration
et
modernisation (1816/ 1870)
Pendant
les
règnes de NAPOLÉON Ier, de Louis XVIII, de
CHARLES X et
de Louis-PHILIPPE, l'histoire du la Mayenne et de la Sarthe est celle
de tous les Français, que les voies de communication ont
rapprochés, que la Révolution a
resserrés; il ne
reste plus ni Manceaux, ni Normands, ni Angevins, ni Bretons, mais des
Français.
La restauration qui met fin aux longues guerres
étrangères, est accueillie dans l'enthousiasme
général. Si la proclamation de la monarchie de
juillet
est encore en 1830 marquée d'une émeute,
l'avènement de la IIème république est
salué des voeux de la grande majorité de la
population et
le 9 avril 1848, c'est le curé-archiprêtre de
Notre-Dame
de Laval qui bénit l'arbre de la liberté.
Les
arts, les
sciences,
les lettres, l’agriculture, le commerce et l'industrie se
sont
développés dans la Mayenne et la Sarthe qui ont
compté, à cette époque, des hommes
remarquables
dans tous les genres.
Le
développement du chemin de fer et des voies
navigables
Jusqu'en
1850, la
circulation des marchandises et des voyageurs est pénible et
coûteuse, sur des routes chaotiques et mal entretenues. Les
voies d'eau
navigables, très utilisées pour la batellerie,
sont
aménagées au début du XIXe
siècle : la Mayenne
est canalisée
sur une longue partie de son cours. L'apparition de la voie
ferrée, dés 1843 (Paris-Orléans),
accompagné du déclin du travail du lin,
entraîne le
déclin et la mort de la batellerie (fin XIX). En
50 ans, le chemin
de fer étend sa toile
d'araignée jusqu'au plus modeste chef-lieu de
département. Partout où il passe, le train
apporte essor
économique et démographique. En Mayenne, il
permet de
limiter le déclin du à la disparition du lin et
d'accompagner le développement des campagnes.
Laval
Avec
la
forte diminution de la toile de lin,
le rôle jusqu'alors prépondérant de la
rivière diminue. La Mayenne canalisée
par plus de 4,5 km de quais de granit devient un lieu de promenade
menant jusqu’aux frontières de la ville qui sont
réservées à l’industrie.
Le
IIème
Empire modifie
profondément l'aspect de la ville par les grands travaux
qu'il effectua. Le viaduc
ferroviaire (1855)
améliore sensiblement la desserte Paris-Rennes. La ligne de
chemin
de fer
Laval-Caen est inaugurée le 6 novembre 1866. Le vieux pont
en
dos d'âne du XIIème siècle est
remplacé par
trois ponts modernes dont le Pont
Neuf en 1815.
L’activité
déployée par les premiers préfets et
par les édiles urbains limite le déclin
démographique
de la ville, qui se précise dès la fin du second
Empire dans tout le département.
Le
renouveau
urbanistique
s’accompagne d’une réelle
amélioration
de l’équipement public
: Laval se dote ainsi d’un musée (1890), de
nombreuses écoles et d’une prison
modèle (1901).
A
lire Une
visite à la crèche
de
rené GADBIN
L'apogée
des campagnes
Le
XIX
e
siècle, c'est l'apparition des cotonnades qui supplantent
rapidement la toile de lin. Le
déclin
de l'industrie
linière oblige l'agriculture
Mayennaise à se reconvertir.
La
Mayenne reste un
département rural dirigée par une aristocratie
foncière qui espère un retour de la monarchie et
reste
attachée à ses terres. Pour pallier à
la perte des
manufactures textile et conserver leur richesse, les notables
réalisent avec succès le passage au
régime de la
polyculture.
Supprimant
les
jachères, fertilisant le sol, améliorant le
rendement des
prairies, développant la culture des
céréales
riches, le monde paysan exploite au mieux les possibilités
de la
terre. La culture constituée presque exclusivement de seigle
et
de sarrasin (et un peu de pomme de terre) en 1835 s'enrichie avec le
trèfle et le
froment
qui devient la culture dominante en
1862.
Cette
expansion
agricole est aussi
liée à l'acquisition
de nouveau matériel
agricole : la
charrue Dombasle
qui, tirée par plusieurs
paires
de bœufs permet un labour profond, la faucheuse et la
moissonneuse. L'emploi
d'
engrais organiques(guano)
et
chimiques (phosphate),
et à la pratique du
chaulage,
permettent l'abandon de la jachère. Les rendements de
céréales passent de 6 à 18 quintaux
par hectare.
Le
développement
des moyens de transport portent leurs fruits : à
l'autoconsommation d'autre fois vient se substituer la
spécialisation
et la commercialisation des produits agricoles.
Délivrés de la crainte de la
disette, les
métayers
du Bas Maine délaissent peu à peu les
céréales pour se consacrer presque uniquement
à l'
élevage
des bovins. Les
chevaux
et les
porcs font leur
apparition au détriment des ovins.
C'est
une
époque
où les village ont connu une activité difficile
à
imaginer dans leur silence actuel. Aux rudes travaux de la semaine
succédait un Dimanche agrémenté de
réunions
bruyantes, de fêtes locales accompagnées de bals.
Autour
du père, les déjeuners dominicaux groupaient une
ou deux
dizaines d'enfants et petits-enfants. Un
artisanat
nombreux
se développe : maçons, charpentiers,
charrons
(fait des
chariots), forgerons, meuniers, tisserands, cordonniers qui
complètent les produits de leur lopin de terre par les
produits
de leur art. A lire :
les
métiers d'autrefois
La
spéculation
agricole enrichie les maîtres de la terre, mais
beaucoup
moins
les métayers et les journaliers.
Cependant,
grâce
à
leur labeur intense et à une épargne
écu par
écu, les petites gens des villages achètent de
petits
lopins de terre. Ces petits
paysans
ont cependant du mal à défendre leurs
intérêts de classe, vis à vis de
propriétaires qui possèdent le pouvoir politique
et qui
se conforment à l'idéologie religieuse dominante,
bien
ancrée dans la société civile. Dans ce
contexte,
la charité est le seul remède à la
misère,
la religion la seule consolation. De 1845 à 1847, les
intempéries sévissent et frappent la population
la plus
pauvre : c'est la disette.
A
lire :
Histoire
de la famille ROUAULT depuis 1834 Louis ROUAULT
Guerre
Franco-Prusse 1870-1871
Le
15 juillet 1870, NAPOLÉON
III déclare la guerre à la Prusse
(15 juillet 1870.) Tout d'abord l'enthousiasme est grand, la population
ne doute pas du résultat. Trois mois après
l'ennemi foule
le sol de la Sarthe ! L'Empire s'est effondré, les 300.000
hommes qui composent son armée sont tués,
blessés
ou faits prisonniers. En
vain Gambetta a
organisé
des armées, les Allemands dont le nombre dépasse
un million avancent toujours.
Le
22 octobre 1870,
Emile de Kératry, ancien préfet de police de
Paris,
propose et obtient la concentration des mobilisés bretons
dans
un camp situé en arrière du Mans, à
Conlie, dans
le but de ravitailler et libérer Paris.
Les
allemands
avancent
toujours : le 12 Janvier 1871 ils font leur entrée au Mans,
le
15 Janvier 1871 ils sont à Sillé et
Saint-Jean-sur-Erve.
Là, les Français infligent des pertes
sérieuses
à l'ennemi qui n'ose plus avancer et s'arrête
le long de la Mayenne.
Quelques jours après, l'armistice suivi de la paix met fin
à cette guerre désastreuse.
Début
de siècle (1871-1914)
Séparation de l'église et de l'état.
En
1907, une
deuxième révolution a lieu : avec la loi de
séparation de l'église et de l'état,
les religieux
et les religieuses n'ont plus le droit d'enseigner avec leur costume.
Beaucoup quittent l'enseignement en France et partent à
l'étranger : en Angleterre, en Belgique. D'autres se
sécularisent et restent sur place.
C'est
la division dans
les
communes et le commencement de l'école privée ou
école catholique. Les parents ont la liberté de
choisir
mais comme les maîtres ne sont pas payés par
l'état
dans l'enseignement privé, les parents doivent payer pour
chaque
enfant une rétribution mensuelle qui sert de traitement pour
les
maîtres.
A
Bais,
l'école
libre ouvre en 1907 après le départ des
religieuses. Dans
l'enseignement Catholique, c'est la grande pénurie de
personnel.
Il y a des dévouements : des personnes munies de leurs
diplômes quittent leur situation et entrent dans
l'Enseignement
A
lire : Centenaire
de la Rouaudière (Histoire de la famille ROUAULT)
Joséphine ROUAULT
La
grande industrie
en marche
Le
développement
de la grande industrie, née sur les bassins houillers (hauts
fourneaux de Lorraines, sidérurgie...) provoque des
changements
notables dans
l'artisanat. Cordonniers et tisserands disparaissent des villages.
Forgerons et Maréchaux-ferrants se reconvertissent en
garagistes
ou plombiers. Les meuniers abandonnent leurs moulins à vent
ou
à eau. Seuls sont restés parmi les anciens
métiers, les maçons et les menuisiers.
A
Laval, le textile,
la
confection et la chaussure permettent de maintenir une certaine
activité, qui compense le déclin de l'artisanat.
Cependant,
l'industrialisation piétine dans le Bas Maine.
La bourgeoisie urbaine et la noblesse des campagnes n'envisagent
guère des investissements de capitaux dans les entreprises
industrielles. Les fonds d'état, le commerce et l'achat de
terre
paraissent de meilleurs placements. De plus, les quelques placements au
Mans ou à Laval se heurtent à de sourdes
oppositions
sociales, à des craintes de désordre ou de
pollution.
La
faible
industrialisation et la démographie accompagnée
d'un
sous-développement industriel, commercial et universitaire
laissent peu d'espoir dans un développement futur de la
région.
1er
Guerre Mondiale
La
guerre va saigner
à blanc la paysannerie, lui enlevant
définitivement une
change de sortir de sa léthargie : 500 à 700
milles
morts, soit 20 % de la population masculine. Et ceci, sans compter les
séquelles physiques et morales des survivants.
L'exode
rural
continue,
malgré tout, car les conditions de vie des paysans sont de
plus
en plus difficiles. Cette nouvelle population de citadins va
être
frappée de plein fouet par la crise des années
30.
Développement
du transport routier
Après
la
première guerre mondiale, on pouvait croire à la
victoire
du train sur la voiture : les pneus crevés, les routes
défoncées par d'innombrables nids de poules...
L'emploi du goudron de houille sur des revêtements plus
épais a remédié à ces
inconvénients.
A
son tour, le
chemin de
fer subit la concurrence de la route parcourue par le camion et la
voiture. Le déclin s'est traduit par la fermeture
des petites voies
départementales, puis se sont les lignes secondaires des
grands réseaux qui disparaissent.
Vie
à la campagne
Dés
1860,
on signale le début
de l'
exode rural,
essentiellement vers Paris, qui offre de nouveaux horizons dans les
entreprises urbaines et les services publics. Cet exode provient aussi
bien de la noblesse, des
petits propriétaires que des ouvriers.
Les descendants de la noblesse et de la bourgeoisie locale,
maîtresse de grands domaines, abandonne l'exploitation
directe de
leurs champs pour des situations plus paisibles dans la banque ou la
haute administration.
Les ouvriers agricoles, quand à eux,
préfèrent un
salaire médiocre dans un taudis citadin plutôt que
la paye
et les conditions de vie misérable de la campagne.
Ensuite
les petits
propriétaires agricoles abandonnent des
parcelles trop petites qui occasionnent un travail
forcené
pour
un revenu insuffisant. La concurrence de produit importé
à meilleur marché (soie, blé,
élevage)
n'arrange rien, malgré des mesures protectionnistes en 1981.
L'exode connaît un sommet vers 1880/1890.
A
la fin du XIXe
siècle, la population rurale ne représente plus
que 38%
de la population, alors qu'elle constituait 75% en début de
siècle ! Le Bas Maine, isolé et à
forte emprise
familiale, est relativement épargné par l'exode
rural :
l'exploitation agricole est une affaire familiale avec encore souvent
bonne et ouvrier agricoles, même si ceux-ci sont plus rares.
La
mécanisation
accompagne l'exode rural : pour compenser le manque de main
d'œuvre, les agriculteurs utilisent la charrue de Dombasle,
la
faucheuse, les
râteaux faneurs et les
moissonneuses-lieuses.
L'effet positif est que la relative rareté de la main
d'œuvre provoque l'augmentation du salaire des ouvriers
agricoles. La
vie à
la
campagne reste difficile : les outils sont médiocres, la vie
est
sédentaire, assez austère et le confort
médiocre.
L'
électricité est
installée dans les
villages (95%
des villages équipés en 1938), parfois dans un
climat de
défiance, mais n'équipe pas encore les campagnes.
A
lire
La
vie à la campagne au début du siècle -
Mes vieux souvenirs
Joséphine ROUAULT
Au
début du XXe siècle, la
campagne souffre d'un
manque de dynamisme, et d'un niveau de productivité
nettement
plus bas que ceux des pays voisins. La création d'un
ministère de l'agriculture
ou des
caisses locales de
crédit agricole ne change rien au
phénomène.
Dés
1926, la crise mondiale aggrave le
phénomène
en frappant l'agriculture en premier lieu : les exportations
s'effondrent.
2eme
Guerre
Mondiale
(1939-1944)
Mayenne
La
cité
de
Mayenne qui n'avait pas revu depuis 150 ans les tourments de la guerre
subit le 9 juin 1944 un terrifiant bombardement aérien qui
coûta la vie à plus de 400 habitants et
détruisit
la majeure partie du faubourg Saint-Martin. Elle fut une
dernière fois transformée en champs de bataille
lors des
combats de la Libération du 6 au 13 Août 1944 : en
se
sacrifiant pour empêcher le dernier pont de sauter, le soldat
américain, J.D. Mac Racken permit aux
blindés du Général Patton de
poursuivre les Allemands.
A
lire la
guerre 1939/1944 et la captivité Joseph SABLE
Les
trentes
glorieuses (1945-1968)
Le
faible dynamisme
des
années d’entre-deux guerres est, heureusement,
compensé par le retour
à la prospérité
qui caractérise les trente glorieuses (1945-1975).
Laval
L’exode
rural fournit alors en
main d’œuvre des entreprises comme LMT ou Thomson
qui viennent compléter une activité
agroalimentaire de pointe
(Besnier).
En périphérie, la ZUP
des Fourches, les ZAC
de Grenoux et du Bourny achèvent la conquête du
plateau
sur la rive droite. Mais c’est la vallée qui
structure
toujours l’essentiel du développement au sud avec
la ZUP
Saint-Nicolas (neuf mille habitants) et au nord vers
Changé-les-Laval.
La
2eme
révolution
agricole
Vers
le milieu du
XXeme
siècle, une deuxième révolution
agricole
s'opère. Les paysans reviennent de la guerre
animés d'une
envie de reconstruire avec des idées différentes
de
celles d'avant la guerre.
L'adaptation
aux
nouvelles techniques
est important, en témoigne l'évolution du nombre
de
tracteurs : l'équipement en tracteur en France
passe de 35
000
en 1938 à un million en 1965!
Une
sélection
de races animales plus performante
permet un développement spectaculaire de
l'élevage bovin,
plaçant la Mayenne parmi les départements les
plus
performants en matière de production laitière et
bouchère. Le lait représente
plus de 40% de la
production
agricole totale, la viande bovine
près de 30 % et la Mayenne
est
respectivement au 5eme et 3eme rang dans ces productions.
Les
rendements de céréales passent de 14 quintaux en
1941
à 36 quintaux en 1968.
L'agriculture
intensive
apparaît, les
troupeaux passent de 10 à 30 bovins.
Les nouvelles technique permettent de gérer des surfaces
beaucoup plus grandes avec moins de personnel. La main
d'œuvre
nécessaire à la ferme est moins nombreuse
provoquant un
exode rural important.
Changement
du mode de vie
La
modernisation
fait
disparaître certains métiers qui n'ont plus lieu
d'être : nourrice, cuisinière.
Déjà
présent chez les bourgeois et les notables, le confort gagne
petit à petit les fermes.
A
Lire : Modernisation
de la Rouaudière
par Michel ROUAULT
Construction de
l'Europe et Mondialisation (1968-2000)
La
PAC
La
progression
constante
de la productivité et la crainte des effets d'une
concurrence
effrénée va conduire à la
création d'une
politique réglementaire de la production au niveau
européen : la Politique Agricole Commune (PAC).
Désormais
la vie des paysans est attachée aux règlements
votés dans ces institutions.
Elle
repose sur :
-
Des prix
institutionnels : le prix indicatif pour le lait, les prix
d'intervention pour le beurre et le lait
écrémé en
poudre,
-
Un soutien du
marché intérieur fondé sur des achats
directs
pratiqués sous certaines conditions par des organismes
d'intervention publics et des aides destinées à
développer l'utilisation des produits laitiers, Une
maîtrise de la
production : le régime des quotas laitiers mis en place en
1984.
-
Un
système
d'échanges caractérisé par: des
restitutions
à l'exportation qui compensent pour les exportateurs la
différence entre le prix de marché communautaire
et le
prix de vente sur le marché mondial ; des droits de douane
fixes
à l'importation prévus au tarif douanier commun.